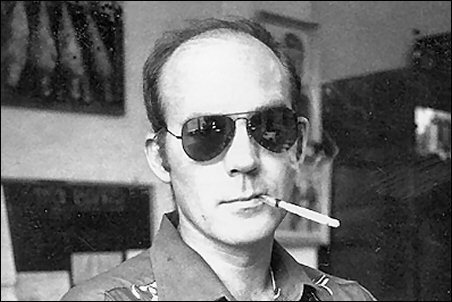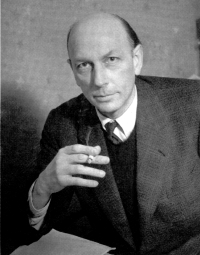Vous allez être redirigé vers le nouveau site dans 10 secondes, ne fermez pas la page !
Dans la nouvelle Cent Vues du mont Fuji, justement, Dazai démonte littéralement l'icône qu'est le mont Fuji. Au lieu d'un bête soumission à la carte postale mythifiée par le peintre Hiroshige, Osamu Dazai prend un malin plaisir à dégommer ce symbole national en nous amenant à nous questionner sur une conviction née d'un matraquage publicitaire. Une certaine irrévérence, on en attendait pas moins de cet autour certes inégal mais tellement touchant.
"Les pentes du mont Fuji convergent à un angle de quatre-vingt-cinq degrés sur les peintures de Hiroshige et de quatre-vingt-quatre degrés sur celles de Bunchô; mais il suffit d'étudier une carte d'état-major pour constater que l'angle des pentes est-ouest est de cent vingt-quatre degrés, et celui des pentes nord-sud, de cent dix-sept degrés. Hiroshige et Bunchô ne font d'ailleurs pas exception : sur presque toutes les représentations du Fuji, l'angle formé par ses pentes est très aigu, ce qui donne effilé, très élevé, très frêle. Chez Hokusai, cet angle est d'à peu près trente degrés : on dirait la tour Eiffel ! En réalité, le Fuji forme un angle obtu : il est tout en pentes douces. Avec ses cent-vingt-quatre degrés dans un sens et ses cent-dix-sept degrés dans l'autre, il n'a rien d'une montagne particulièrement élevée, rien de spectaculaire. Il me semble que si j'étais en Inde ou ailleurs et qu'un aigle vînt me prendre dans ses serres pour me lâcher ensuite au-dessus de la côté du Japon à proximitié de Numazu, je ne serais guère impressionné par le spectacle de cette montagne. "Le Fujiyama, splendeur du Japon" : si les étrangers le trouvent wonderful, c'est parce qu'on leur en a mille fois parlé : c'est devenu pour eux une vision de rêve. Mais supposons que l'on aille à la rencontre du Fuji sans avoir été soumis à tout ce matraquage publicitaire - bref, naïvement, innocemment, avec un coeur qui serait comme une page blanche : dans quelle mesure saurait-on l'apprécier ? Rien n'est acquis. C'est une montagne plutôt petite. Oui, petite par rapport à sa base. Etant donné sa largeur à la base, le Fuji devrait être une fois et demie plus haut."